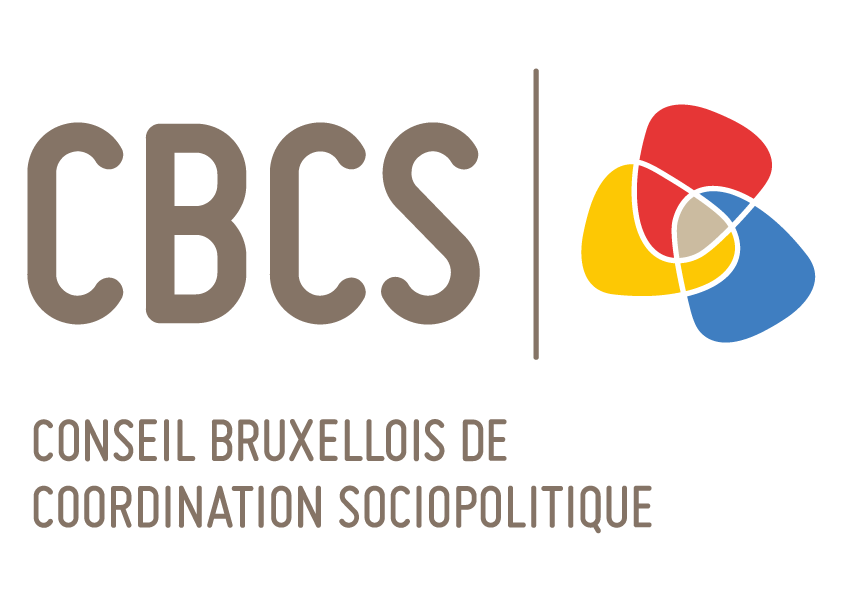Revue Bruxelles Informations Sociales

FAIRE COMMUN,TRAVAIL SOCIAL ET RÉSISTANCES
Comment lutter ensemble – professionnels du social-santé, citoyens-usagers, militants – dans un contexte de crise sociale, économique et politique pour plus de justice sociale ?
Et si, au commencement, il n’y avait que de petites révoltes discrètes à partir des colères et des découragements de chacun qu’il nous fallait transformer en points de résistances collectifs, joyeux et optimistes ? C’est ce que la première édition 2019-2020 de l’Ecole de Transformation Sociale a expérimenté, à partir de cette question : « comment transformer le social pour qu’il transforme la société ? ». Le dossier du Bruxelles Informations Sociales retrace cette expérience tout en la situant plus largement dans le contexte de crise sanitaire du COVID-19. Et questionne le rôle que peut jouer le travail social, une fois cet inédit derrière nous : « Comment assurer les avancées en termes d’égalités sociales et de santé réalisées au plus fort de la crise ? Et comment le travail social peut-il contribuer à les préserver ? ».
Et si, au commencement, il n’y avait que de petites révoltes discrètes à partir des colères et des découragements de chacun qu’il nous fallait transformer en points de résistances collectifs, joyeux et optimistes ? C’est ce que la première édition 2019-2020 de l’Ecole de Transformation Sociale a expérimenté, à partir de cette question : « comment transformer le social pour qu’il transforme la société ? » … Cette histoire est inscrite dans un espace-temps particulier: elle débute avant la crise sanitaire – est interrompue par elle – et livre, à ce stade, des éléments sur la mise en place d’une communauté d’apprentissages et de luttes, encore en émergence. (voir FAIRE COLLECTIF)
Le dossier du Bruxelles Informations Sociales retrace cette expérience tout en la situant plus largement dans le contexte de crise sanitaire du COVID-19. Et questionne le rôle que peut jouer le travail social, une fois cet inédit derrière nous: « Comment assurer les avancées en termes d’égalités sociales et de santé réalisées au plus fort de la crise ? Et comment le travail social peut-il contribuer à les préserver ? », interroge J. Moriau, sociologue (Voir ANALYSE)
Et si nous commencions par élaborer « un récit commun qui rassemblerait plutôt qu’il n’oppose ? », suggère A. Ghijselings, chargé de mobilisations Greenpeace (voir INTERVIEW) Autrement dit, se désaliéner d’un langage qui contribue à cacher certaines réalités sociales plutôt qu’à les prendre en compte : inégalités d’accès aux droits, au travail, au capital culturel, … D’où, l’urgence de « penser avec les moins privilégiés, les invisibilisés, les silenciés. (…) », rappelle V. Georis, praticienne chercheuse à Le Grain asbl. Elle revisite la question du pouvoir d’agir citoyen face à l’invisibilisation de certains dans les prises de décisions politiques. Et prend pour point d’ancrage une interview d’un participant à l’Ecole de Transformation Sociale : « J’existe et en même temps je n’existe pas ». (lire TEMOIGNAGE).
« Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres ». Si cette citation d’Antonio Gramsci a été exhumée par les médias et les réseaux sociaux à l’occasion de l’élection de Donald Trump à la présidence des USA en 2016, on peut aisément la resservir aujourd’hui, note A. Willaert. La question reste entière : le « faire commun » nous sauvera-t-il ? (lire CONCLUSION)
Par Jacques Moriau, sociologue, ULB - CBCS asbl
Faire du Covid un tremplin, travailler le commun
Un effet inattendu de la crise du COVID 19 est d’avoir de façon soudaine et radicale créé un monde commun. Notre nature commune, notre existence biologique nous a fait pendant un moment être soumis au même danger, être vecteur du même risque, partager le même destin. Un virus ne fait pas de discrimination. Mais après ? Une fois cet inédit derrière nous, comment assurer les avancées en termes d’égalités sociales et de santé réalisées au plus fort de la crise ? Et comment le travail social peut-il contribuer à les préserver ? Autant de questions soulevées par cet article avec, comme perspective, le travail du commun, nécessairement lié au développement collectif du pouvoir d’agir.
Potentiellement tous porteurs, potentiellement tous victimes, le virus nous a réduit à nos corps, à de simples machines biochimiques et nous a placé dans une égalité radicale face à la maladie et à ses conséquences.
Cette réalité s’est avérée tellement puissante que, d’un coup, même si ça a pris quelques jours, des problèmes présentés jusqu’ici comme insolubles – le logement de tous les sans-abris par exemple ou l’arrêt des expulsions domiciliaires – trouvaient une réponse immédiate. Ce que des années de revendications et d’efforts portés par les acteurs de terrain n’avaient pas réussi à produire, la maladie infectieuse y parvenait en quelques jours.
S’observe ici toute la force de transformation que recèle la forme de la contagion une fois qu’elle s’immisce dans un corps social. Mus par la peur d’une contamination rapide et d’une désagrégation sociale incontrôlable, les responsables politiques ont mis en place des réponses inédites visant à limiter la propagation du virus.
Dans Surveiller et punir Foucault avait tenté de thématiser ce rapport particulier qui se noue entre maladie infectieuse et technologies de pouvoir en différenciant deux modèles de réponse politique à ce type de danger : celui de la peste et celui de la lèpre.
Le modèle de la lèpre se singularise par une logique d’exclusion. Il s’agit d’expulser le plus vite possible de la communauté celui qui est porteur de la maladie, de le reléguer strictement et d’éviter qu’il entre en contact avec des personnes saines pour que celles-ci puissent, elles, continuer à vivre dans un environnement non infecté. Tri des individus sains et des individus malades, principe d’étanchéité, abandon, tels sont les principes d’action de ce modèle qui discrimine et évacue les malades de la cité. La maladie peut néanmoins encore trouver à s’articuler avec les logiques sociales dominantes en ce sens qu’elle génère de façon hiérarchisée « deux masses étrangères l’une à l’autre » qu’elle classe et, pour l’une d’entre elles, marginalise.
Le modèle de la peste est, à l’inverse, celui d’un espace qui ne connaît pas d’ailleurs, comme l’est notre monde globalisé. Il est celui des grandes concentrations d’individus marquées par la possibilité d’une contagion généralisée du fait de la difficulté de repérer les porteurs. La maladie est potentiellement partout et la priorité est de bloquer sa transmission. Ce modèle est celui de l’isolement, de la surveillance, de l’observation fine et du quadrillage. Il repose sur le contrôle de chacun, l’enregistrement permanent de l’état des personnes et la quarantaine. Ce modèle est celui de l’inclusion. Il s’agit, au contraire du modèle de la lèpre, de traiter toute la population de façon identique, comme un seul corps, mais de différencier finement les états de chacun : «plutôt que le partage massif et binaire entre les uns et les autres, (il) appelle des séparations multiples, des distributions individualisantes, une organisation en profondeur des surveillances et des contrôles, une intensification et une ramification du pouvoir. »
C’est évidemment ce modèle qui a été mis en place au cours de la crise que nous venons de traverser. C’est le recours à celui-ci qui explique la suspension du temps pendant plusieurs mois et la création, dans la peur, d’un monde certes réduit à la cohabitation de corps mais radicalement égalitaire face au virus.
Une égalité sociale éphémère
Avec le SRAS-CoV2, les impératifs de la préservation de la santé publique mixent les obligations de ce que Foucault décrit comme une « médecine urbaine » – préserver la salubrité des agglomérations – et une « médecine de la force de travail » – préserver ceux qui font fonctionner la machine sociale et qui, par la force des choses, se retrouvent « en première ligne » (éboueurs, caissières, livreurs, …) – et font naître une « société de l’égalité ». Cette société tient sur un principe : l’absolue nécessité de préserver la santé des pauvres pour, in fine, préserver celle des riches. Principe qui est au fondement de la mise en place d’une médecine sociale, c’est-à-dire d’une médecine qui cherche avant tout à sauvegarder la société plutôt que les individus.
La nécessité d’égalité sanitaire oblige, pour un moment, à agir aussi sur les inégalités sociales.
C’est ce que va rejouer bientôt, en le délestant de ses obligations égalitaires, la campagne de vaccination généralisée qui permettra à nouveau de découpler la question de l’immunité et celle du traitement social des populations. Une fois chacun protégé du risque d’infection, le modèle de la peste ne sera plus d’application et la gestion sanitaire ne nécessitera plus d’agir sur les conditions de vie des populations, mais uniquement sur les aspects liés directement à la maladie.
Il y a donc fort à parier que les quatre mois de confinement/déconfinement que nous venons de vivre n’auront été qu’une parenthèse dans l’expérience que nous avons de la vie sociale. Quatre mois où l’on aura été forcé, avec plus ou moins de bonne volonté, d’entrain ou de plaisir « à faire commun ». Quatre mois pendant lesquels tout le monde s’est retrouvé logé, y compris les SDF, les migrants et les habitants des marges de notre cité, à la même enseigne.
Unir nos forces vs renoncer
Je retire deux enseignements de ce moment, unique à bien des égards. D’abord que la construction, plus ou moins volontairement pilotée par le politique et les médias, d’une situation de catastrophe ouvre des possibilités inattendues d’unifier les volontés, de viser des objectifs partagés en estompant de façon rarement vue les hiérarchies sociales et les dynamiques d’exclusion. Il ne faut évidemment pas négliger les raisons, très spécifiques, qui sont à l’origine de cette expérience mais l’indication d’une ouverture vers de telles possibilités est en soi encourageante. Par ailleurs, cette période de confinement témoigne aussi d’un certain renoncement généralisé à agir sur la situation et d’une (trop) bonne volonté à s’en remettre à l’autorité politique dans l’espoir du salut. Des décisions radicales de privation de libertés de circulation ou de rassemblement d’associations ont été acceptées sans broncher. La généralisation à grande échelle de pratiques de contrôle a reçu l’assentiment du plus grand nombre. De même, le débat public sur la définition de la crise, ses conséquences et la détermination des moyens à mobiliser pour la combattre a été pratiquement inexistant et l’ensemble des propositions et des décisions rapidement laissées au mains des seuls « experts ». Le retour « à la normale » plus ou moins assuré, les rapports sociaux anciens ont alors repris le dessus et ont plus ou moins étouffé les prémices de nouveaux agencements.
Autrement dit, la période que nous vivons est assurément exceptionnelle et étrangement porteuse d’espoir en ce qu’elle permet d’apercevoir un autre horizon que celui de la concurrence généralisée, des inégalités structurelles et de la défiance. Elle indique d’autres directions, d’autres possibles. Mais le rapide retour à la normale montre aussi que l’idée du commun ne perdure pas si on ne le travaille pas. Ce qu’indique cette crise c’est que, s’il y a moyen de faire commun en théorie, il faut encore trouver les moyens pratiques de le réaliser avant que l’idée ne s’évanouisse.
Nous sommes actuellement à la croisée des chemins. Des avancées énormes, inimaginables qui vont vers plus d’égalité ont été réalisées au plus fort de la crise : hébergement des sans-abris, moratoires divers, arrêt des expulsions, dégagement de budget pour les populations précarisées, augmentation de budget pour les services sociaux et de santé, … Mais comment les assurer ? Comment continuer à faire de notre monde un « monde commun » comme la COVID nous a forcé à le faire ? Et comment le travail social peut-il y contribuer ?

La force du commun
Il faut d’abord revenir sur l’idée même de commun. Qu’est-ce que recouvre ce terme ?
Le commun c’est d’abord un principe politique qui lie l’affirmation d’une démocratie radicale (rien à propos de moi sans moi, pas de décision sans participation à la prise de décision) et la détermination des questions qui ne peuvent trouver de réponses que collectives et débattues (les biens et services communs). Ce « principe du commun », qui essaie de s’affranchir à la fois des injonctions technocratiques et des dynamiques inégalitaires du marché, repose sur la reconnaissance du fait que nous sommes, à bien des niveaux, engagés dans une aventure commune qui nous met en situation de « co-obligation » (comme on dit être l’obligé de) née de notre participation à une tâche collégiale.
Mais, comme l’indique Nicolas-Le Strat, pas de commun, pas de monde commun, sans travail du commun : il y a une interdépendance nécessaire entre travail du commun et développement collectif du pouvoir d’agir (empowerment). C’est dire la nécessité d’une lutte qui va à l’encontre des incapacitations, des impuissances construites par les montages institutionnels actuels.
Entre la privatisation du monde et l’extension infinie de la propriété privée (commodification), l’emprise de l’Etat sur des biens et des services publics qui échappent à la volonté populaire, le principe du commun repose sur une volonté d’étendre les coopérations et les collaborations à partir desquelles nous pouvons « construire des communs et nous rapporter à eux pour les préserver, les étendre et les faire vivre ».
« Comment outiller ce « travail du commun », comment le concevoir et comment l’œuvrer ? Avec quels outils langagiers, techniques, relationnels, conceptuels ? Comment « capaciter » cette volonté de faire ensemble ? Quels sont les dispositifs et les méthodes, les langages et les concepts, qui instrumentent notre faculté à agir en commun (coopérer) et à agir le commun (autogérer) ? Quelles formes institutionnelles faut-il établir pour espérer concrétiser cet engagement ? »
Cette liste de questions pratiques montre à quel point l’expérience du confinement est loin d’une réelle tentative de construction de monde commun. Elle permet néanmoins de réfléchir à ce que nous pouvons apprendre des dernières expérimentations et tentatives réalisées dans le travail social, ce que nous pouvons en garder et ce que nous devons améliorer.
Autrement dit, la période que nous vivons est assurément exceptionnelle et étrangement porteuse d’espoir en ce qu’elle permet d’apercevoir un autre horizon que celui de la concurrence généralisée, des inégalités structurelles et de la défiance. Elle indique d’autres directions, d’autres possibles. Mais le rapide retour à la normale montre aussi que l’idée du commun ne perdure pas si on ne le travaille pas. Ce qu’indique cette crise c’est que, s’il y a moyen de faire commun en théorie, il faut encore trouver les moyens pratiques de le réaliser avant que l’idée ne s’évanouisse.
Nous sommes actuellement à la croisée des chemins. Des avancées énormes, inimaginables qui vont vers plus d’égalité ont été réalisées au plus fort de la crise : hébergement des sans-abris, moratoires divers, arrêt des expulsions, dégagement de budget pour les populations précarisées, augmentation de budget pour les services sociaux et de santé, … Mais comment les assurer ? Comment continuer à faire de notre monde un « monde commun » comme la COVID nous a forcé à le faire ? Et comment le travail social peut-il y contribuer ?
Trois constats
- construire du commun n’est pas plus facile aujourd’hui (même si nous pouvons nous appuyer sur l’exemple du confinement et de ses effets) dans « le monde d’après »,
- le travail social associatif ne sort pas renforcé de cette crise. Il s’est trouvé lui aussi confiné, empêché de mener une partie de ses missions et d’apporter le soutien nécessaire à toute une part de la population. Il a cependant montré sa réactivité, un certaine force face à l’exceptionnel (c’est le secteur associatif qui s’est le premier préoccupé des populations les plus fragiles), des possibilités de plasticité et de coordination insoupçonnées (comme dans le cas des hôtels réquisitionnés),
- les formes existantes ou émergentes de commun sont des ressources inestimables sur lesquelles s’appuyer pour poursuivre le chemin vers un horizon de justice sociale et d’autogouvernement. A cet égard, les dispositifs liés à la Sécurité sociale, et de façon générale les services publics, ont montré toute leur importance dans cette crise et sont des mécanismes à préserver et à renforcer, absolument. De même, le milieu naturel, au plus proche de chacun de nous, est le premier bien commun à défendre. Il est, bien avant toutes les institutions humaines, le socle indispensable sur lequel bâtir la possibilité d’une vie politique en commun.
Des ouvertures
La crise du COVID 19 peut nous servir de tremplin. Par son ampleur et la démesure de ses conséquences, elle nous a amené à réviser certaines manières de faire ou certaines évidences. Elle nous a obligé à revoir des partitions jusqu’alors immuables ou à imaginer atteignables des objectifs jusqu’ici barrés. En s’appuyant sur ces expériences, nous pouvons décider de suivre de nouvelles routes et imaginer de nouvelles façons de les parcourir. Comme le proclamait le philosophe Bruno Latour au plus fort de la crise, « si tout est arrêté, tout peut être remis en cause » !
Alors, que garder et renforcer et quoi abandonner ou tenter de faire disparaître ?
En premier lieu, à l’opposé d’une gestion technocratique de la crise, alliant parole experte et forces sécuritaires, réaffirmons le pouvoir d’agir de l’association, à partir du moment ou la volonté de s’associer signifie celle d’affronter en commun des problèmes eux-mêmes identifiés et vécus en commun (ce qui ne veut pas dire de manière identique). La force de l’associatif rappelle le Collectif 21 qui s’oppose aux prescrits du nouveau Code des sociétés et des associations, émane de l’énergie propre aux collectifs et de leur capacité à dépasser les barrières et les micro-appartenances pour produire du commun.
S’associer, s’organiser, c’est chercher la bonne échelle et la bonne forme de soutien et de solidarité entre le lien purement familier et l’approche technocratique : « un travail du commun peut répondre à cette nécessité de réengager une réflexion d’ensemble sur les aides, les solidarités et les accompagnements ». L’association est le premier pas dans le travail de découverte de ce qui nous importe collectivement et des efforts que nous devons produire pour le faire prospérer.
C’est ce qu’on a vu poindre lors du confinement à la fois dans le développement de solidarités locales et organisées – les Brigades de solidarité populaires par exemple- mais aussi dans le souci généralisé vis-à-vis des personnes plus fragiles (les migrants, les personnes âgées, les occupants des MR/MRS). Celui-ci témoignait d’une attention, partagée très largement, de ne pas nuire en respectant les précautions sanitaires mais aussi d’un attachement au travail de soin qui dépasse la dispensation de soins techniques dans une certaine éthique du care, notamment en faisant attention aussi bien aux soignés qu’aux soignants.
Alors, que garder et renforcer et quoi abandonner ou tenter de faire disparaître ?
En premier lieu, à l’opposé d’une gestion technocratique de la crise, alliant parole experte et forces sécuritaires, réaffirmons le pouvoir d’agir de l’association, à partir du moment ou la volonté de s’associer signifie celle d’affronter en commun des problèmes eux-mêmes identifiés et vécus en commun (ce qui ne veut pas dire de manière identique). La force de l’associatif rappelle le Collectif 21 qui s’oppose aux prescrits du nouveau Code des sociétés et des associations, émane de l’énergie propre aux collectifs et de leur capacité à dépasser les barrières et les micro-appartenances pour produire du commun.
S’associer, s’organiser, c’est chercher la bonne échelle et la bonne forme de soutien et de solidarité entre le lien purement familier et l’approche technocratique : « un travail du commun peut répondre à cette nécessité de réengager une réflexion d’ensemble sur les aides, les solidarités et les accompagnements ». L’association est le premier pas dans le travail de découverte de ce qui nous importe collectivement et des efforts que nous devons produire pour le faire prospérer.
C’est ce qu’on a vu poindre lors du confinement à la fois dans le développement de solidarités locales et organisées – les Brigades de solidarité populaires par exemple- mais aussi dans le souci généralisé vis-à-vis des personnes plus fragiles (les migrants, les personnes âgées, les occupants des MR/MRS). Celui-ci témoignait d’une attention, partagée très largement, de ne pas nuire en respectant les précautions sanitaires mais aussi d’un attachement au travail de soin qui dépasse la dispensation de soins techniques dans une certaine éthique du care, notamment en faisant attention aussi bien aux soignés qu’aux soignants.
Vision commune : professionnels et usagers !
Cette attention partagée montre la voie vers d’autres façons d’envisager l’action associative, plus horizontales et plus communautaires. Une action associative moins attachée à la partition des rôles, des attentes et des initiatives entre professionnels et usagers qu’à la production commune des questions à résoudre, des actions à mener et des conditions de leur réalisation. Cela suppose évidemment de créer ou d’utiliser des outils qui permettent ce travail de conjonction menant à une réflexion, une enquête et une action communes. C’est cette voie que des expériences récentes comme l’Ecole de Transformation Sociale ou le CREBIS veulent aider à explorer en contribuant à casser les barrières entre les rôles qui nous nous assignons et en créant des lieux permettant ce travail du commun.
Les évènements récents apportent un deuxième enseignement : il n’est plus concevable de considérer les questions de la santé et du logement comme nous y invitent les logiques de gestion étatique ou d’accaparation marchande. Ce qu’a fait apparaître la crise liée au coronavirus est que la santé ne peut se réduire au fait d’échapper individuellement à la maladie, pas plus que le logement ne peut s’envisager comme une mesure sanitaire.
Santé comme logement ne sont pas des objets d’intervention, c’est en fait de nos vies toutes entières qu’il s’agit, du sens qu’on leur donne et de la façon dont on entend les conduire ! Enjeux politiques et collectifs, la santé et le logement sont aussi des biens communs et c’est cette qualité qui doit guider le travail social qui s’en préoccupe. Un travail basé sur l’idée qu’il s ‘agit de « prendre soin » de tous et de chacun, non pas dans un optique compensatrice ou réparatrice mais dans la perspective d’une obligation partagée du fait de notre commune vulnérabilité, doit se centrer prioritairement sur la préservation de la santé de chacun (accès universel) et la revendication d’un toit pour tous (droit au logement).
Car le commun ne peut pas être seulement une idée. Pour que les choses deviennent communes, il faut du matériel, des institutions, etc…. Le commun s’institue dans des formes d’organisation, des formes de distribution de ressources, des capacités techniques, etc. Le travail social, comme travail du commun, doit être partie de cette force d’émancipation et appui à la détermination collective.
L’égalité effective que nous avons expérimentée de façon fugace est promise à disparaître dès que la maladie sera contenue et que le modèle de la peste, qui permet ironiquement l’inclusion de chacun, pourra se transformer en un « modèle de la variole ». La question ne sera plus alors d’assigner les gens aux lieux et de réduire l’infection mais de tracer des risques différenciés en pouvant contrôler constamment déplacements et contacts. Ce modèle du contrôle de chacun par chacun via les outils techniques réduira d’autant plus les possibilités de construction d’un monde commun. Et permettra le retour au monde d’avant…en pire.
Le COVID a brutalement ouvert des brèches, ne les laissons pas se refermer.
Par S. Devlésaver, CBCS asbl
Ecole de transformation sociale : construire une communauté de pratiques et de résistances
« Comment transformer le travail social pour qu’il transforme la société ? ». À partir d’octobre 2019, une centaine de travailleurs sociaux, chercheurs, militants, citoyens, … se sont rassemblés autour de cette question. Initiée par Le Forum – Bruxelles contre les inégalités, la première édition de l’Ecole de Transformation Sociale avait pour défi de construire ensemble des parties de réponses. La crise du Covid-19 a coupé le processus en plein vol. En mars 20201, le dispositif et ses chantiers de réflexion ont été brutalement suspendus. Et pourtant. Même si les actions collectives concrètes n’ont pas eu lieu, se frotter à la joyeuseté bordélique d’une communauté d’apprentissage en émergence nous en apprend déjà beaucoup : entre émulation collective, croisements d’expériences et de regards, lot de frustrations et de tensions multiples, se confirme un besoin vital et vivifiant de « faire ensemble autrement ». Pour preuve : l’Abécédaire de la transformation sociale, une plateforme web de résistance collective, en construction. Focus sur ce cheminement collectif.
Qui veut transformer le travail social ? Et pourquoi ?
Vendredi 11 octobre 2019. Au centre de Bruxelles, à deux pas de la Bourse, c’est la base de lancement pour le projet d’école de transformation sociale. 300 personnes ont répondu à cet appel : « Pour se relever, il est urgent de travailler la dimension politique, émancipatrice, mais aussi subversive du travail social ». Parmi eux, 120 se sont déjà engagés à poursuivre les réflexions et actions qui auront émergé de ce premier rendez-vous à travers d’autres sessions de travail. (Lire p.18 )
Mais qui sont ces gens qui veulent transformer le travail social ? La société ? Quelle mouche les a piqués pour avoir envie de participer à l’aventure ?
« La rébellion est un point de départ, mais pas suffisant! » - Paulo Freire, pédagogue brésilien -
Il y a avant tout, ce qui les rassemble : organisateurs, animateurs comme participants travaillent, luttent, réfléchissent ou se débattent avec le social au quotidien. Tous sont confrontés à des mêmes constats, sans véritable issue. Tous se frottent, se confrontent, de très près ou d’un peu plus loin, à une série de problématiques sociales : sans-abrisme, mal-logement, chômage, santé mentale, décrochage scolaire,… Certains les vivent ou les ont vécues et sont aujourd’hui pair-aidants dans des associations (fonction qui privilégie l’expertise du vécu ou « savoir expérientiel »), d’autres les prennent pour objet d’étude ou les ont pour matière d’enseignement (« savoir académique »), d’autres encore accompagnent, au quotidien, des personnes invisibilisées dans la société (« savoir professionnel »). Assistant social dans un service psycho-médico-social à bas seuil d’accès, enseignant dans une haute école sociale, militante dans un collectif de lutte pour les sans-papiers, chercheur en politiques sociales, éducateur de
rue, artiste engagé, fonctionnaire sur les matières social-santé, infirmière en milieu associatif, … Tous sont plein d’attentes : « ce que je souhaite, confiera un participant, c’est d’être bombardé de questionnements et être mis en cause sur presque tout, voire sur tout ! (…) Ce que j’espère, c’est que le moi qui est entré à l’ETS ne soit pas le moi qui en ressort. Sinon, j’aurai raté quelque chose ! ». Autres confidences : « je viens pour faire quelque chose de ma colère » ; « Le travail social a besoin d’un bon petit coup de pied aux fesses. Osons sortir de nos tombeaux, bureaux, routines, institutions. Il n’y a pas de magie sans un petit grain de folie ? On devrait en tirer quelque chose ? »
Comment débuter un dialogue à 300 personnes ?
Dans les grandes lignes et sur papier, l’école se définit comme un dispositif de formation participatif et partagé. Avec pour ambition de « créer une communauté de participants ; construire une vision et une conscience politiques du social ; développer des réponses originales et créatives face aux enjeux sociaux, sociétaux et structurels ; créer des actions hors des schémas standards ». OK, mais concrètement, comment s’y prendre ? Comment initier un processus collectif ? Comment aller au-delà des constats maintes fois répétés ? Comment éviter les discussions de comptoir ? Ou bien c’est justement là que tout commence ? … « Ce qu’on préfère le plus souvent dans les colloques, ce sont les moments de rencontres », souligne Nicolas De Kuyssche (Le Forum-Bruxelles contre les inégalités) en introduction à l’événement. « Imaginons cette journée à l’image d’une immense pause-café, d’une longue conversation informelle ! ».
Le ton est donné, à l’image de la méthodologie du jour, « le forum ouvert ». « Libre à chacun de circuler entre les différentes discussions, de prendre des moments de recul, des initiatives spontanées pour que quelque chose se construise ensemble ». La journée débutera d’ailleurs par la rédaction collective, en un temps record, d’un ordre du jour. Au total, ce sont 55 discussions qui auront lieu, par petits groupes, à trois moments différents de la journée. « Comme pour un processus d’écriture, tu dois lâcher prise, laisser venir, dans le moment présent », me prévient-on. « L’intérêt, c’est le croisement des genres, des idées, des métiers, … ».
Dans ce brouhaha à la fois jovial et concentré, on butine de-ci, de-là, On accueille le hasard, les détours. On se disperse un peu beaucoup, on rit, on rencontre, on tente d’attraper des réflexions en plein vol. Si l’exercice n’est pas toujours évident – faire place à chacun et construire d’une même voix, laisser émerger une parole libre et dépasser les constats, circuler et entrer en dialogue – stimulant, il l’est très certainement.
De ces discussions, il en ressort avant tout une multitude de questions ! « On demande aux personnes accompagnées de participer à des processus collectifs alors qu’elles ont plein de soucis individuels… Comment ne pas forcer le collectif ? ». « Comment travailler sur le pouvoir d’agir des personnes en tant que travailleur social ? ». « Comment bousculer les manières de travailler tant qu’il y a un ‘nous’ – les professionnels du social » – et un ‘eux’ – les personnes accompagnées ? ». « Où s’arrête notre travail ? », « Comment donner la parole à ceux qui ne l’ont pas ou plus ? », etc. etc. A en donner le tournis ! A en paralyser les travailleurs sociaux et le travail social lui-même ? … Mais à travers elles, il y a aussi cette occasion, relativement inédite, de partager des expériences et des projets situés par-delà les frontières de sa sphère de travail habituelle, de son entourage quotidien. On vient donc pour s’imprégner, voir, entendre. On ne vient pas toujours pour prendre la parole ou passer directement à l’action.
L’Ecole de Transformation Sociale, c’est quoi ?
Initiée par Le Forum – Bruxelles contre les inégalités, l’Ecole de Transformation Sociale se définit comme un dispositif de formation participatif et partagé. Les objectifs sont :
• créer une communauté de participants ; • construire une vision et une conscience politiques du social ;
• développer des réponses originales et créatives face aux enjeux sociaux, sociétaux et structurel ;
• créer des actions hors des schémas standards.
Voilà dans les grandes lignes. Les participants sont composés de 3 types d’expertise : professionnelle, expérientielle (à partir de son vécu) et académique. Mais au-delà de cette diversité de regards, il y a ce qui les rassemble : organisateurs comme participants travaillent, luttent ou se débattent avec le social au quotidien. Tous se frottent, se confrontent, de très près ou d’un peu plus loin, à une série de problématiques sociales : sans-abrisme, mal-logement, chômage, santé mentale, décrochage scolaire, …
En fin de journée, point de rencontre sur les marches de la Bourse : les participants brandissent des calicots calligraphiés de slogans tirés des discussions : « Rien sur nous sans nous ! », « A bas la hiérarchie des savoirs ! », « Nos patrons, ce sont les gens ! », « Tisser les colères pour vivre au lieu de survivre ! », « Repolitisons-nous ! », « Accompagné, pas fliqué ! », « Nos savoirs, c’est du pouvoir ! », etc. Une manière de de faire prendre l’air à une série de réflexions qui traversent le travail social, de faire irruption dans l’espace public. Une manière aussi de relayer des bouts de révolte et de colère communes vers l’extérieur. Mais l’énergie collective a besoin de repos : les participants se quittent, fatigués, enthousiastes ou encore frustrés, … Mais rarement indifférents suite à ce foisonnement d’idées partagées.
En chantiers : l’émergence d’un collectif en 5 tensions-clés
Les mois suivants, le travail se poursuit avec 120 participants, à partir de différents groupes de réflexion thématiques ou chantiers : « Formation sociale émancipatrice », « social-climat : même combat ! », « Les publics invisibilisés », « Contrôle, violences institutionnelles et travail social », « désobéissance civile », « Pair-aidance », « Plaidoyer social ». Au fil des séances, on a rencontré, observé, écouté, participé, pris des notes. Au fil des sessions, on a laissé trainer nos yeux et nos oreilles, mais aussi lors des réunions de préparation entre animateurs.
On a aussi interrogé des participants pendant et après les journées. En voici un condensé, réorganisé autour de 5 tensions majeures qui ont traversé cette première édition. A voir comme un outil-boussole qui peut orienter tout un chacun dans les équilibres à (ré)inventer pour créer du « commun ».
TENSION N°1
Temps pour se rencontrer ou passer à l’action ?
« 8 jours [5 jours, vu la crise sanitaire, ndlr], c’est court si on veut aboutir à une action concrète qui porte ses fruits durablement ».
A chaque rendez-vous, dès 9h, les lieux se remplissent d’une énergie bruyante, curieuse, souvent amusée et décontractée.
On se salue, on se reconnaît, on prend des nouvelles les uns des autres. Autour de petites gorgées de café, d’une tranche de gâteau. Pour réveiller têtes et papilles. On en était où déjà ? … Ah oui : « transformer le social pour qu’il transforme la société ». Qui y croit ici ? », lance Juliette, l’une des animatrices ETS, sous forme de boutade, à la première journée… Une main se lève : « moi, je suis là parce que je pensais qu’on était 120 à y croire ! ». Tout est dit ou presque. Un grand nombre de participants sont là pour « faire collectif ». Et comment le faire si ce n’est à travers le temps de la rencontre ? « Apprendre à connaître le beau panel humain qui nous entoure », « toutes des personnes ayant la même envie de militance, même si vécues sous diverses formes, toutes utiles », confient les participants. Pour certains d’entre eux, les temps informels rendent ces échanges possibles. Pour d’autres, ceux-ci restent trop maigres. Même en chantier, le temps aurait finalement manqué pour se connaître, parler de sa propre expérience et tisser une véritable confiance les uns entre les autres. « J’ai eu la sensation d’être dans des speed-dating », regrette un participant. Une autre tempère : « Heureusement, la pression du temps est diluée grâce à l’accueil, la bienveillance du dispositif. Ce qui me permet de vivre l’expérience comme un vent de fraîcheur ! ».
Le collectif ETS en 5 tensions-clés
Tension n°1 — Temps pour se rencontrer ou passer à l’action ?
Tension n°2 — Laisser émerger ou planifier ?
Tension n°3 — Parole d’expert ou parole de vécu ?
Tension n°4 — Pouvoir d’agir individuel ou collectif ?
Tension n°5 — Faire commun : entre-soi ou avec les autres ?
Pression du temps, pression du résultat ?
Toujours est-il que ce processus ETS, malgré la mise en place d’un cadre souple, aurait été « mangé » par « des journées très (trop) intenses, même si très riches ». Comme dans une ruche au bourdonnement continu, certaines abeilles auraient eu besoin, à certains moments, de se poser. Pour « repartir avec quelque chose qui va [nous] faire cheminer ». Résultat : on rêve encore et toujours plus de « temps long » : « Si on pouvait avoir deux jours consécutifs par mois, ce serait carrément le luxe. Ça permettrait de profiter de l’émulation ambiante, puis de laisser décanter le reste du mois ».
« Faire collectif signifie aussi s’arcbouter tous ensemble face aux coups qu’on peut recevoir » - un participant à l'Ecole de Transformation Sociale
Au fil des séances, se creuse cette tension entre, d’un côté, ceux qui veulent prendre le temps de se rencontrer, de réfléchir ensemble – « Je comprends l’envie d’agir, c’est le but de l’expérience, mais pour moi, agir pour agir revient à s’agiter dans le vide et perdre des forces pour une action qui en vaut la peine » – et de l’autre, ceux qui s’impatientent et veulent passer à l’action : « J’avais un peu l’impression d’être en psychiatrie : on cause beaucoup, on agit peu ». Les deux versants – réfléchir et agir – sont pourtant indissociables. « Ce que j’ai appris à l’ETS », témoignera en ce sens une participante, « c’est ce savant mélange entre le travail sur le temps long et puis, parfois, ce temps de l’urgence où il faut foncer dans le tas pour éviter de tourner en rond ! ».
L’arrêt brutal de l’ETS et de ses chantiers en cours, à la mi-mars 2020, en raison de la crise sanitaire, laisseront un goût d’inachevé à l’aventure : « J’ai tissé des liens et eu accès à des ressources intéressantes, mais j’aurais souhaité poursuivre avec une application concrète ».
Que ce soit pour rencontrer, réfléchir ou agir, les temps qu’on pourrait parfois désigner comme « morts, creux ou encore vides » sont au fond des respirations essentielles à préserver dans une idée de construction à la fois individuelle et collective. « On doit réapprendre le temps de la lutte, on a oublié ce que cela peut représenter en termes de combat, de douleur », rappelle un participant. « Faire collectif signifie aussi s’arcbouter tous ensemble face aux coups qu’on peut recevoir ». Et pour construire une lutte durable, le point de départ serait ce temps long de l’échange, à partir duquel quelque chose pourrait basculer.
TENSION N°2
Laisser émerger ou planifier ?
« Ce qui m’a manqué, c’était d’avoir un peu plus de cadre dans le travail en chantier : j’ai eu l’impression que les discussions restaient davantage à un niveau théorique parce qu’on ne savait pas vers quoi aller… »
Autre journée, autre question posée par un des animateurs : « avez-vous un exemple d’action sociale collective que vous souhaiteriez entreprendre ? » … Grand silence général.
Même si les envies de changement sont là, « mettre plein d’idées ensemble, c’est une soupe compliquée ! », note un participant. Pour preuve, les rythmes et besoins si variés de chacun des chantiers en construction. Certains ont besoin de temps, d’autres de personnes ressources sur telle ou telle thématique, d’autres encore se demandent comment insuffler de la créativité, comment évaluer l’impact de leur action, comment passer de l’individu à l’action collective, etc. L’ensemble de ces besoins traduit la
difficulté à se situer entre l’émergence d’une proposition collective et sa planification. Personne n’a la vision globale de l’ensemble du contenu, et c’est tant mieux ! Mais la nécessité de resserrer le propos se fait sentir : « ne pourrait-on pas poser un cadre moins large et aborder dès le départ des problématiques plus concrètes ? ». Pour rappel, pour cette première édition, l’ETS partait des 55 problématiques relayées dans le cadre du Forum ouvert. (lire p.) Vaste et périlleuse entreprise ! Trop vaste pour ne pas s’embourber un peu dans le tas de questions sociales à prendre à bras le corps. Parce qu’on a promis de construire ensemble. Parce qu’on ne veut pas décevoir, encore moins frustrer, dès le début de l’aventure. Et parce qu’on veut laisser le cadre le plus ouvert possible. Mais pour certains des participants, la scène est jugée trop large : « parfois, cela flottait un peu, tout était à discuter ! ».
Garder le fil de l’histoire …
Pour donner un rythme et des points de repères, le groupe d’animateurs (facilitateurs), garants du processus collectif, est primordial. Mais lui-même doit être le plus au clair possible avec son rôle et les limites dans lesquelles il peut jouer : « jusqu’où sommes-nous animateurs ? jusqu’où sommes-nous aussi participants ? », s’interroge une des animatrices, à l’occasion d’une réunion de debriefing. Elle poursuit : « nous sommes plein de doutes sur notre fonctionnement, mais une confiance s’installe entre nous, ce qui nous permet d’avancer ! Partager ses doutes, ses maladresses, poser un regard indulgent sur nos essais-erreurs est essentiel ». (Lire encadré page de droite) Au fil de l’expérience, apparaît la nécessité d’affiner un maximum la place des animateurs dans le processus pour éviter notamment d’endosser celle de « super-héros » du collectif, censée assumer tous les rôles en un seul.
Au fond, tout ceci nous rappelle cela : délimiter l’espace dans lequel on va travailler ensemble et les rôles de chacun ne nous empêchera pas pour autant de voguer librement à l’intérieur … Que du contraire : « imposer un cadre, c’est ce qui va m’aider à oser fouiller chez moi là où je n’ai pas envie d’aller, c’est ce qui aide à m’interroger, à me remettre en question ! ».
Autrement dit, si le dispositif ETS ne doit pas être un mode d’emploi de « mise en action du collectif », il doit idéalement être là pour fixer un cadre de travail rigoureux et sécurisant qui ne bouge pas. Et qui s’appuie sur une vision politique partagée. Dans ce cas précis, il s’agit de mettre à plat et de clarifier, d’abord entre animateurs pour le faire ensuite avec l’ensemble des participants, les différentes visions de changements du travail social ; fil rouge qui sera garant de l’objectif à atteindre collectivement. Pour au-dedans et par-delà, laisser libre cours à la préparation du bouillon collectif.
TENSION N°3
Paroles d’experts ou paroles de vécu ?
« Belle mixité chaque vendredi. Tout ce beau monde rassemblé me mettait de bonne humeur dès le matin. Les CPAS (Centres Publics d’Action Sociale) qui ne sont pas toujours invités dans ce genre d’évènements – et c’est regrettable – étaient très présents. J’ai aussi adoré travailler et échanger avec des « experts du vécu ».
« Le premier jour, j’ai recroisé Joe qui vit dans la rue. Ce qui m’a amené de la joie et des questions », témoigne une participante. Une autre souligne : « Rien à faire, ce sont les plus à l’aise qui prennent (trop ?) de place ». La question du « comment travailler avec des regards et profils différents » est au coeur de l’ETS. Pour rappel, les participants sont composés de 3 types d’expertise : professionnelle, expérientielle (à partir de son vécu) et académique ou institutionnelle. Comment faire collaborer des chercheurs, des intervenants sociaux, des citoyens militants, des artistes engagés, des experts du vécu, des fonctionnaires administratifs, des usagers de service social ? … Comment exploiter cette précieuse ressource de multiplicité de regards et de points de vue sans pour autant re-catégoriser les profils, ré-hiérarchiser les savoirs ? La diversité des groupes – experts du vécu, professionnels, chercheurs, jeunes et moins jeunes -, les rencontres entre différentes visions du monde, l’écoute et le respect des différents points de vue sont autant d’éléments pointés comme des richesses par les participants.
Mais doutes et difficultés à se comprendre sont aussi au rendez-vous : « Comment dialoguer entre monde politique, travail de terrain et engagement citoyen ? ». « Entre militance et bienveillance, arriverons-nous à faire émerger quelque chose ? ».
Rôle de l’animateur : super héros, garant du processus collectif ?
Avant chaque journée ETS, l’ensemble des animateurs se réunit 3 à 4h pour débriefer, ajuster le dispositif, co-construire la suite.
Lors de ces réunions de préparation, ils ont vite constaté une zone de flou autour de leur rôle de « facilitateur », « animateur », qui rend leur tâche souvent inconfortable : « sommes-nous des passeurs de savoirs ? A-t-on un devoir de mémoire envers les chantiers ? Un rôle de transmission de ce qui se construit vers l’extérieur ? Notre rôle est-il d’être garant du cadre et/ou d’apporter de l’épaisseur à ce qui se dit ? Devons-nous nous définir comme des personnes ressources à disposition des différents chantiers ; ou, au contraire, être responsable d’un chantier en particulier ? comment être garant du processus et, en même temps, laisser cheminer les participants ? »
Après évaluation de cette première édition, il apparaît combien la fonction de « facilitateur/ distributeur de la parole » est première. D’autant plus quand sont inclus dans le collectif des personnes moins accoutumées avec les modes d’expression orales, plus vite intimidées par le groupe, etc. D’où, l’importance aussi d’installer des duos d’animateurs, l’un étant plus attentif à la distribution de la parole, l’autre aux contenus de la discussion en lien avec les objectifs poursuivis. Au-delà de ce recadrage, l’équipe d’animateurs soulignera aussi la volonté de construire un socle de balises pédagogiques et de visions politiques communs.
Parce que si les animateurs proviennent d’un même terreau associatif, chacun n’en a pas moins cultivé une culture pédagogique et d’animation spécifique, liée notamment à son institution, sa vision politique du travail social, son parcours personnel, professionnel, militant.
Surmontables pour certains, « des divergences par moment, mais qui ne sont pas des obstacles » ; plus paralysants pour d’autres : « En octobre, J’ai trouvé des alliés dans les envies de changer le monde. En février, le bilan est que côtoyer des universitaires pour travailler ensemble est compliqué, qu’il y a des évidences énoncées que l’on n’a pas le temps de décortiquer. Bref, j’ai un peu la sensation que le monde de terrain non universitaire et le monde universitaire ont un sacré travail s’ils veulent collaborer un jour ! ».
Nombreux sont pourtant les outils proposés pour dépasser cette sensation d’impasse – panneaux ressources avec portraits de chacun « qui est qui ? », « ce que j’ai à offrir/ce que je recherche », fragmentation des journées en travail par sous-groupes, distribution de la parole, … pour favoriser un échange horizontal. Elles n’ont permis de répondre que partiellement au défi.
Une fois la porte du collectif refermée …
Malgré aussi une attention et une habileté (agilité ?) des animateurs à tenter de « faire commun », certaines questions n’ont pu trouver de réponse dans certains chantiers : « quelle va être notre action ? A qui va-t-elle être destinée ? ». Pour certains participants, « mélanger des publics avec de tels écarts de connaissances et de pratiques est une belle envie, mais qui exige beaucoup plus de temps ! ». Parce que, de mois en mois, la porte de l’ETS une fois refermée, le sentiment d’appartenance au groupe s’effiloche, les contenus aussi : « quand on se retrouve après autant de semaines, on a l’impression de tout devoir reprendre à zéro ! ». L’écart se creuse d’autant plus entre ceux qui ont l’habitude de passer par l’outil informatique – lectures de conversations et de documents échangés sur Agorakit (logiciel collaboratif ), de lire des études et analyses… Et puis, les autres. Même son de cloche pour le travail en chantiers : « portés par nos habitudes et notre enthousiasme, les discussions vont vite, on a l’habitude de rester 2h sur une chaise et on n’a pas peur de parler en petits groupes… ». Mais toutes ces « habitudes » de travail pour certains rendent la parole d’autres participants trop peu écoutées, voire silencieuses : « Tout allait très vite. Je cautionnais ce qui était dit, mais j’étais l’invisible dans le groupe des « publics invisibilisés » ! Je me suis effacée plutôt que de prendre ma place. Je suis avant tout une personne d’écriture et me sens vite écrasée, paniquée à l’oral ! ». « Ce qui est dit m’intéresse », confie une autre participante, « mais les mots utilisés sont compliqués, je n’ai pas tout compris, on parle vite et beaucoup ! ».
Comment faire collectif au-delà de ces modes de fonctionnement qui nous rattrapent ? … « Personnellement immergée dans cette culture de l’argumentaire, j’avais envie d’amener beaucoup d’informations et en même temps, j’avais cette peur de trop la ramener, d’avancer à la manière d’un buldozer! », confie une participante. Comment éviter les rapports de domination dans les échanges ? Quel pouvoir donner à l’expertise académique ?3 ; canaliser la parole des uns et inviter la parole des autres à s’inscrire dans le groupe ? Utiliser d’autres supports de transmission que le langage oral ? Comment mieux outiller les participants pour atteindre un consensus sans qu’il soit frustrant pour une partie du groupe ? Bref, comment faire collectif AVEC tous ? …
Pour certains, le collectif ETS est encore trop majoritairement composé de « travailleurs sociaux, blancs, plutôt entre 30-40 ans ». Une part égale de travailleurs sociaux, experts du vécu, académiques – pourrait-elle favoriser cette dynamique de réciprocité ? Et pourquoi ne pas instituer des duos d’animation de chantiers « professionnel du social/expert du vécu » ? Une manière d’accueillir davantage les personnes en prise directe avec les problématiques sociales ? « Si on les invite, on doit leur faire une vraie place pour qu’elles puissent s’exprimer ! », insiste une des animatrices.
Cette question de la participation des personnes invisibilisées, « silenciées » a été présente tout au long des rencontres. Elle a d’ailleurs fait l’objet d’un chantier à part entière et a permis de se pencher sur ce type de réflexions : « être présent dans un processus collectif en tant qu’usager, OK, mais pour quoi faire ? Avec quelle place ? Qu’est-ce qu’on attend de nous ? Qu’on témoigne de nos difficultés, de nos obstacles de vie ? » … « Et si je veux être expert du vécu du côté de la joie ? Si je veux venir pour être sur autre chose que sur la fragilité de mon vécu ? », rétorque un participant. Une autre explique : « Je suis invisible et j’en ai souffert. Les schémas catégoriels sont absurdes. Parfois, on voudrait avoir droit à une parole, à une voix et paradoxalement, à d’autres moments, on veut juste être invisible pour être comme les autres ». Si la participation des personnes marginalisées est décrétée et unanimement applaudie, elle reste encore concrètement un impensé.
TENSION N°4
Pouvoir d’agir individuel ou collectif ?
« Théophile, tu ne dois pas oublier que les mots ont du poids, un sens, une origine, … Bref, les mots sont riches de sens. (…) D’ailleurs, si on ne met pas les mêmes couleurs sur les mots, cela risque d’être compliqué ! ».(Extrait de conclusion d’une journée ETS, décembre 2019.)
Très vite, le collectif ETS se pose la question du vocabulaire utilisé : « si on veut impulser une autre forme de travail social avec les personnes accompagnées, les travailleurs de terrain, ne faudrait-il pas renommer nos pratiques ? ». Inventer une nouvelle terminologie du travail social pour s’approprier les outils et influencer la transformation sociale souhaitée. Voilà l’idée. Avec l’aide de Zin TV, média d’action collective, « L’Abécédaire de la transformation sociale » voit le jour. (https ://zintv.org) Au départ de regards et d’expériences individuelles récoltées au fil des rencontres, une parole collective se construit. Et pointe les incohérences dans lesquelles le travail social est pris, la nécessité de faire bouger les lignes. Par fragments – d’abord des capsules vidéos, mais aussi de l’écriture, des illustrations, des photos, … – autant de petits pas vers un outil de lutte sociale collective ? Vers un outil de résistance pour lutter contre un travail social, trop souvent lui-même reproducteur de violences et d’inégalités sociales ? … Concrètement, il s’agit par exemple de s’interroger sur le terme « Assistanat » : « où sont les assistés ? où sont les assistants ? » … Ne plus parler de « ceux d’en haut et ceux d’en bas » pour mieux écouter. Pour « arrêter de parler ‘à la place de’, arrêter de mettre des corps intermédiaires » …
Débuter par les mots. Et puis agir !
Il est donc question du pouvoir des mots, et parallèlement, du pouvoir vs impuissance du travail social : « En tant que travailleur social, on a un certain pouvoir, on peut faire bouger des choses » ; « à Bruxelles Laïque, on a créé un dispositif pour porter la parole des gens « invisibilisés » (sans emploi). Mais, au final, on reste davantage dans le prendre soin. Alors, que fait-on au-delà de l’écoute active ? Je ne sais pas je ne sais plus, ma propre énergie s’en va » … Comme si l’émulation collective se cognait sans cesse aux impasses de la structuration du travail social, telle qu’elle existe aujourd’hui. Même dans un dispositif de construction collective comme l’ETS, passer de l’expérience individuelle à un pouvoir d’agir collectif et politique semble un pari hasardeux, une gageure. Comment favoriser ce passage des expériences individuelles à une action, à un message collectif ? Comment développer ce « pouvoir d’agir » individuel et collectif ? Une participante témoigne de cette nécessité d’allier les deux : « A la fin de mes études, j’ai été amenée à me défendre en justice face au CPAS de ma commune : il m’avait sanctionnée. Résultat : plus de Revenu d’intégration Sociale (RIS), le mois de ma remise de mon Travail de Fin d’Etudes. J’ai fait appel, une première fois avec un avocat, et j’ai perdu. Seconde tentative, seule, et j’ai gagné ! J’ai gagné le combat, mais tous les autres », s’inquiète-t-elle, « tous ceux qui n’arriveront pas à se défendre et recevront ce couteau dans le dos… ». Ce combat personnel l’a conduite à parler de son histoire devant divers publics, soutenue par diverses organisations : le Réseau Belge de Lutte contre la Pauvreté, la Plateforme Justice pour Tous, Netwerk tegen Armoede, etc. Elle a développé des liens avec un collectif extérieur au CPAS. A travers ces démarches, l’objectif est de faire pression collectivement pour, au final, obtenir un meilleur accompagnement des bénéficiaires dans leur suivi. Comme le souligne cette expérience, le processus de transformation sociale commence par soi-même. Et débute petit. Tout petit : « pour faire bouger les choses, commençons à un endroit précis, à partir d’une situation concrète, à partir d’un collectif d’acteurs et des énergies déjà en mouvement à l’échelle d’un quartier par exemple », insiste-telle.
Une autre participante rappelle l’intérêt d’avoir dans l’ETS des personnes qui se situent des deux côtés de la relation : des intervenants sociaux et des usagers. « On peut en profiter pour questionner nos postures, y être attentifs et grandir de ce processus de remise en question sur les violences qu’on produit et qu’on répercute dans nos propres rapports avec les personnes accompagnées », conclut-elle. Ne pas négliger l’importance de passer par les mots, la force du témoignage, de l’échange pour ensuite s’approprier un discours commun et agir collectivement.
TENSION N°5
Faire « commun » ? Entre-soi ou avec les autres ?
« J’ai vraiment ressenti une impression de solidarité, de partage de savoirs, la sensation de me sentir entourée de gens engagés (un peu similaire à la sensation que l’on peut ressentir en allant manifester). Cela fait du bien et a un réel effet « porteur » et galvanisant. On se sent moins seuls, plus fort ensemble, plus complémentaires et plus audacieux ».
« La joie est le secret de la résistance » - Alice Walker, écrivaine et militante féministe
A propos de l’expérience ETS, on entend des termes comme « complexe » et « défi » qui reflètent le lent cheminement à tâtons, mais aussi des mots comme « plaisir », « révolution », « choix », « mouvement », « complémentaire », « encourageant », « collectif », « ensemble », « expérience », … Révélateurs d’une émulation positive, palpable mais pas facile à décrire, autour d’une construction commune, d’une aventure en cours et qui se poursuit malgré les obstacles, qui fait circuler une forme d’énergie positive collective. Pour une participante, l’idée était de travailler « autour du commun. Ce commun que les politiques ultraliberales démolissent, dont on devrait faire valoir l’importance ». Mais ce commun, bien qu’il réunisse un « groupe de personnes qui partage des valeurs et veille à ce qu’elles soient accessibles à tous, c’est aussi un ensemble qui s’adapte, qui bouge, se modifie ». Ce qui n’est pas forcément évident. Au fil des journées ETS, certains participants quittent le bateau, d’autres montent à bord. Même si un noyau dur se retrouve de session en session, ces allers-et-retour ne sont pas évidents pour tout le monde : « ce qui m’a fort déstabilisée, c’est la mouvance du groupe, certains qui partent, d’autres qui arrivent ». Heureusement, beaucoup d’entre eux se reconnaissent, se sourient, prennent des nouvelles d’une session à l’autre autour d’un café, d’un sandwich. Heureusement, l’accueil, la bienveillance, les liens tissés peu à peu avec les uns entre les autres permettent de se remettre au travail, de retrouver ses marques dans une certaine aspiration commune.
Ouvrir grand portes et fenêtres ?
Au fond, « quelle est la force de l’ETS ? Qu’est-ce qui fait qu’on y revient ? Qu’on y trouve, au-delà des frustrations, du sens et du plaisir ? »… Plusieurs tentatives de définition ont émergé. Pour certains, l’école de transformation Sociale serait « un rassemblement d’acteurs sociaux dans le but de faire émerger des points de lutte » ; pour d’autres, « une communauté de pratiques et de savoirs pour apprendre et faire réseau ». Pour certains, le dispositif a été vécu comme « une petite respiration », « une chouette dynamique », empreinte de « bonne humeur et d’enthousiasme ». Ou encore comme un espace pour « redonner du sens au travail social ». Lieu où les « vrais mots – qu’on n’ose plus toujours dire tout haut- peuvent être énoncés clairement : violence institutionnelle, indécence (à propos de l’aide caritative), classes sociales, dégénérescence de l’état social, mépris du travail de terrain… ».
D’autres ont vécu cette première expérience avec la peur au ventre de ne pas « atterrir » et de rester dans un débat d’idées. Peur aussi de ne pas être assez connecté avec l’extérieur. D’où, la décision d’inviter les chantiers à sortir des murs de l’ETS ou d’inviter des personnes ressources extérieure. Certains iront découvrir un projet d’agriculture urbaine, participative et écologique à Watermael-Boitsfort ; d’autres resteront pour écouter le témoignage de Bernadette Schaek de l’ADAS (association de défense des allocataires sociaux). D’autres encore participeront à un lunch-débat autour d’experts du « plaidoyer »3 « Enrichissant », « concret », « impressionnant », « intéressant » sont autant d’adjectifs qui qualifieront ces moments de partages avec d’autres ressources, d’autres projets et personnalités inspirantes. D’où, le retour à cette question : comment sortir de notre bulle de travail, cloisonné par secteur : santé mentale, action sociale, économie sociale, éducation, … ? Comment faire converger les luttes ? (lire l’interview, p.) « Pourquoi ne pas faire certains exercices dans la rue pour que le commun des mortels s’interroge sur ce que nous faisons ? », propose une participante. On les informerait : « ici des travailleurs sociaux se rassemblent parce qu’ils n’en peuvent plus et veulent du changement ! ». Pour une autre, il est essentiel de se rapprocher du monde culturel : « les artistes posent un regard différent, ils ont une militance du côté du sensible, de la joie, du vivant… Et on a envie de ça, on en a tellement besoin dans le travail social pour inventer une autre façon de faire ».
Sans la crise sanitaire, qu’aurait-on créé ensemble ? Peut-être beaucoup plus, peut-être trois fois rien. Une seule certitude : « ce dispositif ETS répond à un besoin pour garder le plaisir dans nos métiers », affirmeront plusieurs participants. « Il y avait comme une nourriture, un apport collectif qui m’a fait grandir », résumera un autre. Même retour du côté des organisateurs : « beaucoup de découvertes et d’apprentissages à partir de cette question partagée : ‘comment travailler ensemble ? » …
La force de cette première édition ETS est bel et bien de permettre à un tel collectif d’émerger et de rendre visible ce besoin vital et vivifiant de « faire ensemble ». Sa richesse est d’identifier tant les points de tensions que les points de luttes communes. En d’autres mots, prendre conscience de cette force du collectif et « réintroduire dans le travail social une dimension festive, subversive et résolument optimiste » dans un processus d’apprentissage mutuel permanent. A l’image de ces organisateurs des TTIP Game Over en 2016-2017 : « Même si ce combat est triste, grave, laid, dangereux, cela n’empêche pas qu’on peut le combattre en étant joyeux : c’est cette face-là de la médaille qu’on veut. Cette face est pleine de solidarité, d’action collective et de bonne humeur. Cela nous rend plus forts face à ceux qu’on combat ».3
Parce que « réapprendre à rêver et à espérer, à utiliser sa faculté de créativité pour ouvrir le champ des possibles est indispensable pour construire du neuf ».4
Parce que les luttes ne font que commencer.

Par Véronique Georis, praticienne chercheuse à Le Grain asbl et directrice de AMOS
L’école de transformation sociale : une expérience à interroger
Au cours de l’actuelle crise sanitaire, la cohabitation avec l’incertain s’est imposée comme question majeure dans l’ensemble des milieux humains fragilisés par la pandémie. L’effacement de pans entiers – métiers du soin, maisons de repos, sans abris, quartiers populaires, …- de la société sont devenues patentes. A la suite de l’interruption générale provoquée par la COVID 19, Le Grain se propose modestement de revisiter la question du pouvoir d’agir citoyen des invisibilisés. Dans une posture de praticienne chercheuse, Véronique Georis interroge en premier lieu la situation des personnes invisibilisées et rendues silencieuses à l’intérieur même de l’expérience de l’Ecole de transformation sociale (ETS).
L’école de transformation sociale : une expérience à interroger
Au mois d’octobre 2019 démarre l’expérience de l’école de transformation sociale (ETS) à laquelle Le Grain s’associe. (…) La publicité du projet indique qu’il s’agit de « travailler la dimension politique, émancipatrice, mais aussi subversive du travail social ». Elle s’adresse aux « travailleurs sociaux, chercheurs, militants, citoyens, […] qui ont trop souvent un sentiment d’impuissance et d’inertie. »
Après une première séance de consultation, différents ateliers se mettent en action : « Formation sociale émancipatrice », « social-climat : même combat ! », « Les publics invisibilisés », « Contrôle, violences institutionnelles et travail social », « désobéissance civile », « Pair-aidance », « Plaidoyer social ». (voir « Faire collectif »)
L’ETS s’est interrompue avec le confinement sans pouvoir s’évaluer ni mener à bien les chantiers entamés suite aux choix des participant.e.s. Mon objectif dans cet article est de rendre compte d’une série de questions posées par le chantier des invisibilisé.e.s, restées en suspens, ainsi que des tentatives de déploiement d’un pouvoir d’agir à partir de ce groupe.
Je prends pour point d’ancrage une interview d’un participant au chantier des invisibilisé.e.s, membre du syndicat des Immenses, inscrit grâce au rapport de force instauré par le coordinateur de cette institution. A travers une approche réflexive, j’en souligne la puissance et la fragilité : potentiel d’action qui peut être silencié par des codes et des interprétations dominants. En second lieu, je donne des points de repères pour nourrir et consolider une communauté de pratiques et de savoirs, vecteur de développement du pouvoir d’agir des invisibilisés de ce monde en crise. (télécharger le BIS papier n°177)
Le récit de A., participant à l’ETS
Autour de la question de la place de chacun.e à l’école de transformation sociale et des mécanismes qui provoquent l’invisibilisation-silenciation, A., participant en cette dernière réunion du chantier des invisibilisé.e.s d’avant COVID (le 14.02.2020), m’a fait part de son expérience ; comment il avait pu s’inscrire et comment sa participation à l’ETS résonne avec sa vie « sans papier ». Son récit de vie bouleverse les codes admis:
« J’ai eu connaissance de l’école de transformation sociale grâce à une présentation orale, plusieurs membres du syndicat se sont inscrits via le formulaire en ligne, ils ont répondu aux questions. Lors de la sélection, seul le coordinateur du Syndicat des Immenses a été retenu. Il a exigé que des membres puissent également participer. Les ordinateurs nous rendent invisibles. Il a fallu que notre coordinateur insiste.
J’ai été absent à deux journées de l’ETS, mais c’est parce que j’étais malade. Avant d’être en Belgique j’étais en Espagne, je travaillais dans la soudure. J’ai eu un accident, j’ai perdu la moitié de mon pied, j’étais à moitié déclaré et je n’ai eu qu’une demi-pension. Je vis dans un endroit humide et donc quelquefois je suis bloqué, je croyais que mes chaussures étaient solides mais à l’intérieur mes pieds sont mouillés. Parfois je n’arrive plus à marcher, je suis bloqué à cause de l’amputation.
Je suis motivé à transformer la société en général. Normalement, l’air et l’eau devraient être gratuits, on est né comme ça. Maintenant, depuis que je suis en Belgique, je ne sais où dormir, manger, mon temps est consacré à tourner en rond. J’ai été transformé par le temps qui passe. On devient comme un lion qui se défend dans la jungle. Il y a les loups, les renards, les voitures, les camions, …
Il ne faut pas toucher les autres, pourtant il y a les oiseaux qui nettoient les dents des crocodiles ou la peau des éléphants. On a peur des autres, peur de dire une vérité qui ne sera pas acceptée, mais personne ne peut se cacher derrière son ombre.
Pour nous, c’est foutu mais je participe à l’éducation des enfants (6). Les toucher permet de moins gaspiller le temps, de dire vraiment ce qui se passe. Par exemple, apprendre à pouvoir dire la vérité. Quand la facture d’électricité arrive, expliquer correctement ce qui se passe sans colère, sans honte. On n’est pas des mendiants, on a le droit d’être comme on est.
Je n’ai pas de papiers, donc pas de permis de conduire. Comment dois-je faire pour me déplacer ? Pourquoi ne puis-je pas avoir un âne ? (dans mon pays d’origine, c’était mon mode de déplacement)
Je ne veux pas entrer dans le programme de la carte bancaire : dettes, factures, … 0n te coupe le logement, l’eau, le gaz sans que tu puisses parler.
Il y a du désordre, des « faux usages bureaucratiques ». Il faut respecter l’usage des objets afin qu’il n’y ait pas de perte, pas de gaspillage. Des gens utilisent la force pour dominer les autres personnes. Ce sont les pirates des mers. Ils nous donnent des « faux usages », par exemple les droits existent sur papiers mais pas dans la réalité. Les droits sont invisibles comme moi. Le corps a besoin de papiers pour exister. Pourtant, je suis en ordre. Je m’appelle A., je ne suis pas faux, touchez-moi. Je me reconnais. Je n’ai pas besoin d’ordinateur pour parler à ma place.
J’existe et en même temps je n’existe pas. Voilà ce que j’entends jour après jour :
Ici, c’est interdit. Tu es étranger.
J’ai pas le droit de circuler ? je ne suis pas humain ?
L’humain est invisible. On reste Belge ou Algérien. Comment trouver une solution à un problème international monstrueux, au déploiement d’une pieuvre internationale ? Le service social de Bruxelles travaille pour l’étranger parce qu’il n’y a pas de système social en Algérie, pas de ramassage des déchets.
Ici, je mange les déchets.
Faut-il un assistant social ou un avocat ? Il me semble que l’avocat connaît mieux les droits.
Pourquoi je suis triste ? Même pendant la fête, il y a de la tristesse. Il y a un malaise. Toujours le mal tourne dans la tête. Pourquoi je ne suis pas content ? Pourquoi je suis fâché ? La peur ne va pas avec le sentiment d’être content ».
Approche réflexive
A. me parle comme il lancerait encore une fois une bouée à la mer. Il me regarde droit dans les yeux. Sans honte. Il interroge sincèrement et âprement l’incohérence du monde dans lequel il est plongé sans pouvoir réellement y appartenir officiellement. Il est fier de contribuer à l’éducation des enfants, d’aller dans les écoles partager son expérience humaine.
Il apporte des réponses aux questions posées pendant le chantier. Son absence est due à sa santé déficiente, due à ses conditions de vie et à ses difficultés de mobilité suite à un accident.
Il questionne le sens du travail social lui-même : s’agit-il de défendre des droits ou d’aider à supporter une réalité sociale intangible ? Il situe la problématique de l’accueil dans son contexte international et dans le contexte de son pays d’origine où il n’y a pas de sécurité sociale.
Il décrit de manière imagée la violence de la rue à laquelle il est quotidiennement confronté et celle du monde du travail, sans protection sociale. Il se révolte contre les mésusages de la bureaucratie, contre l’exigence abusive de papiers qui efface l’être humain.
Nous avons eu le temps de réaliser pendant le confinement à quel point ces rencontres en face à face sont essentielles, à quel point les ordinateurs et les masques effacent la réalité émotionnelle, les expressions du corps, les 80 pour cent de la communication non verbale.
Au-delà des chiffres et des mots sur le papier, les sons prononcés et écoutés au cours d’un face à face possèdent une force inégalée. Je n’ai pas eu le temps de partager cet entretien avec le groupe, je n’ai pas revu A., depuis le mois de février. Ce récit personnel devait faciliter sa présentation lors d’un parcours d’artistes organisé avec Douche Flux.
Ce texte révèle la puissance et la fragilité d’un tel témoignage. L’histoire personnelle racontée recèle un potentiel d’action pour la personne concernée et pour tous ceux qui le liront ou l’entendront. Potentiel d’action silencié par les codes et les interprétations dominants. En tant que collectif, le syndicat des Immenses auquel appartient A. semble soutenir véritablement ce travail de passage d’un monde à l’autre.
Interview de Amaury Ghijselings, chargé de mobilisations, Greenpeace
«Si on veut faire du commun, évitons le piège des narratifs dominants ! ».
En mouvement, c’est un peu ce qui semble définir Amaury Ghijselings, chargé de mobilisations chez Greenpeace et militant depuis… toujours ? A 15 ans, entre deux tubes de Rage Against The Machine, il a pour livre de chevet le manifeste du parti communiste. Plus tard, il fonde avec d’autres amis La Volte asbl, et s’engage sur de multiples causes : Climate justice action, camp No Border de Bruxelles, Marche européenne des Indignés, … Il interpelle aussi sur l’urgence de « faire ensemble » à travers une « conférence gesticulée »*. La question sociale, « elle fait partie de mon vécu », avoue-t-il, « même si ma réflexion sur les questions de justice sociale s’est complexifiée avec le temps ». Retour sur cet échange passionnant qui invite à poursuivre la « convergence des luttes », au-delà des difficultés pour construire ce « nous collectif ».
BIS : D’où vient votre conscientisation politique ? Et pourquoi ce choix de travailler professionnellement sur la question climatique ?
Amaury Ghijselings : J’ai grandi dans un environnement précaire. Ma mère a élevé seule ses trois enfants. Et malgré un emploi de secrétaire dans un cabinet d’avocats, c’était difficile pour elle de joindre les deux bouts. Par la suite, j’ai côtoyé des femmes féministes dans mon boulot à l’asbl Quinoa. Au fil de mon parcours professionnel, j’ai fait les liens entre lutte contre le patriarcat, anticapitalisme, colonialisme, exploitation et enfin, écologie radicale. Au fond, on peut encore vivre des siècles sans résoudre les dominations, mais la crise climatique, on ne peut pas ! Ce qui ne veut pas dire qu’il faut d’abord s’emparer de la question du climat. On ne pourra définitivement pas la résoudre sans s’attaquer aussi au patriarcat, au colonialisme, etc.
Faire « commun », « faire société » est donc un incontournable …
Oui, même si aujourd’hui, le rapprochement des luttes environnementales et sociales est encore maladroit. Du côté du mouvement climatique, on entend ce type de discours : « il faut résoudre la question climatique tout en faisant attention à la question sociale et aux pauvres ! ». Le problème, c’est que cela revient à dire qu’il y a une contrainte supplémentaire !
Comment construire un véritable « nous »?
La seule manière d’y arriver, c’est de réaliser un vrai changement d’échelle au niveau des politiques publiques ! Avec les populations pauvres et les moyens revenus, et pas uniquement du côté des populations riches. Actuellement, tout est axé sur la propriété privée plutôt qu’à partir des entreprises publiques. La véritable question est : « de quoi a-t-on besoin pour assurer les besoins sociaux et environnementaux de la société dans un intérêt commun ? ».
Le libre marché entraine une privatisation à outrance : l’énergie, l’eau, le gaz, l’électricité, … Au lieu de fonctionner à partir de l’offre et de la demande, l’idée serait de redistribuer les revenus, mettre fin aux dominations économiques et racistes, … Concrètement, au lieu de défiscaliser les propriétaires pour qu’ils construisent ou adaptent leur maison en mode « écologique », on devrait isoler tous les logements sociaux, instaurer la gratuité des transports en commun, réduire le temps de travail, etc. De même, du côté des entreprises, c’est trop tard pour attendre qu’elles passent aux énergies vertes ! Il n’y a pas de lien entre exonérations fiscales et créations d’emplois … Produire moins et mieux partager, voilà ce en quoi je crois !
Les problématiques qui nous relient et la manière de les résoudre sont largement partagées. Mais comment se fait-il qu’on n’arrive pas à passer ensemble à l’action ?
Le tout est dans le narratif. La clé de la convergence des luttes, c’est l’histoire que nous voulons raconter ! Si on veut faire commun, il ne faut pas tomber dans le panneau des narratifs dominants, mal pensés et relayés massivement par les médias. Le narratif actuel oppose : le travailleur social est opposé au militant écologiste, l’ouvrier au cadre, etc. Nous devons élaborer nos propres narratifs. Nous sommes unis ! Des politiques publiques existent et nous devons faire en sorte de les améliorer.
Les mots utilisés orienteraient nos luttes ?
Avant cela, il y a cette question des subsides, basée sur une logique cartésienne qui dissocie, nous isole1. Mais au-delà de cet aspect-là, nous sommes effectivement aliénés par un langage qui cible certaines portes d’entrée et en invisibilise d’autres comme l’accès au travail, le racisme structurel, la violence policière, l’accès au capital culturel, … D’où, la nécessité de se poser cette question : « que contribue-t-on à invisibiliser aujourd’hui ? »
Par où commencer pour y répondre ? Et faire émerger ce qui nous relie ?
S’émanciper, s’éduquer les uns les autres, remettre l’économie à sa place. Comprendre comment tout cela fonctionne, notamment à travers l’éducation populaire. Proposer des alternatives économiques, arriver à contre-attaquer. Pour ce faire, des mouvements tels que Greenpeace sont plus libres – non subsidiés, indépendant de l’Etat – alors que les autres types d’ONG s’épuisent : beaucoup de colloques pour discuter, mais au final « comment on en sort ? Comment on avance ? »… On sait ce qu’on doit faire mais on n’y parvient pas ! D’où, selon moi, la solution est d’accompagner les gens à pouvoir résister, retrouver une puissance d’agir, au-delà de ce système de subsides parce qu’être en rupture totale, cela reste compliqué ! S’autoriser à être subversif, bouger les lignes à l’intérieur de ce type de financements. Personnellement, je n’ai jamais entendu d’associations à qui on avait coupé ses subsides parce que trop subversives. Il y a parfois aussi une forme d’auto-censure, une collaboration volontaire.
Le besoin de créer des cercles de diffusion révèle la nécessité impérieuse de sortir de « l’entre-soi » propre au secteur associatif.
L’associatif aurait tout intérêt à s’autoriser, selon vous, à désobéir ?
Quand il y a de nouvelles normes, se poser en tout cas cette question : on accepte ou pas ? La désobéissance est effectivement un des leviers de changement puissant. Cette « Action directe non violente créative » est le terrain où je retrouve personnellement le plus d’expérience d’émancipation. Mais je ne dirai jamais que tout le monde doit le faire. Tout le monde n’a pas les moyens de vivre avec des incertitudes d’agenda, des risques d’altercations policières, etc. La désobéissance civile est un privilège, sans doute moins adapté pour les plus dominés, vu l’exposition au risque plus grand quand on est sans papier, non blanc, avec moins de capital culturel, social, économique, … On n’est pas tous égaux !
La désobéissance civile, c’est quoi ?!
Dans son analyse (1), Béatrice Bosschaert rappelle que le concept de la désobéissance civile a été développé par Henry David Thoreau, écrivain américain (1817-1862) dans son essai, la » Désobéissance civile » dès 1849. Il visait « une rébellion contre l’Etat et contre certaines lois jugées iniques ou injustes. Il inspira Martin Luther King et Gandhi. Pour faire changer une loi, ces derniers incitaient au non-respect de celle-ci ; appliquant ce qu’Aristote disait déjà : « Le fait qu’une loi puisse être injuste fonde la possibilité qu’on y désobéisse. » Le procès de Nuremberg en 1945 a été un tournant dans l’histoire de la désobéissance car il a établi le devoir de désobéir aux lois iniques en condamnant ceux qui y avaient obéi.
Depuis, la désobéissance civile prend aussi des formes plus indirectes. Les infractions ne sont pas nécessairement en lien avec l’objet de la contestation. Elles sont mises en oeuvre pour attirer l’attention, pour réveiller les « consciences endormies ». (…) La désobéissance civile est une vraie source de changement social, comme le rappelle John Jordan, co-organisateur des Climate Games : « Toute forme de changement, ce qu’on peut appeler le progrès social, est le résultat d’actions de désobéissance. Les femmes qui portent des pantalons, le week-end, la contraception, le mariage gay, tous ces acquis sont les résultats d’actions menées par des gens qui ont désobéi, qui ont fait de la prison, qui ont été tués, qui ont été vus par la société comme des fous, des terroristes, etc. »
Extraits de : (1) « Gamification de la désobéissance civile, quand le jeu suscite l’engagement », Le Grain asbl, septembre 2018 : www.legrainasbl.org/
« Tout le monde n’a pas la liberté d’être libre », soulignait effectivement une participante sans-papier à l’ETS. Il s’agit alors de trouver d’autres voies …
Oui, et il en existe tant d’autres pour changer le monde ! Faire avec l’Etat (plaidoyers, mobilisations conventionnelles, …) ; faire sans l’Etat (le changement ne dépend pas de l’Etat : les alternatives sont ici et maintenant ; créer un Gasap par exemple) ou encore faire contre et résister (désobéir). Le plus important est de trouver la manière qui convient à chacun et éviter d’être dans l’éthique sacrificielle pour changer les choses ! Il n’y a pas une bonne réponse à cette question du « comment faire commun », le monde change tellement vite, les répertoires d’actions, les travailleurs également.
D’où, l’importance d’articuler les différentes approches ?
On fait partie d’un mouvement qui nous dépasse dans lequel on joue chacun un rôle différent. Un mouvement dans lequel on a aussi tout intérêt à pondérer les moments de production et d’analyse, à se réapproprier la recherche-action, à intégrer des activités intersectorielles dans le travail des structures elles-mêmes… Mais la question du comment on s’articule au mieux les uns aux autres en un seul et même mouvement de lutte, c’est la question du narratif !
Plus on aura effectivement de convergences les uns entre les autres, plus notre mouvement prendra racines !
Par Alain Willaert, coordinateur général, CBCS asbl
Basculement ou effondrement ?
« Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres ». Si cette citation d’Antonio Gramsci a été exhumée par les médias et les réseaux sociaux à l’occasion de l’élection de Donald Trump à la présidence des USA en 2016, on peut aisément la resservir aujourd’hui.
Le réchauffement climatique qui impose de manière insistante son agenda météorologique ; la crise politique (belge, européenne, mondiale) dont la vigueur croissante affaiblit la démocratie et porte à la remilitarisation des nations ; la gestion d’une pandémie qui augmente grandement les inégalités sociales au sein de la population et banalise les mesures de ségrégation sociale (et raciale) ; les forces de l’ordre qui, de Blankenberge à Charleroi en passant par Saint-Gilles et Bruxelles-Ville, surréagissent de manière de plus en plus musclées : que voici un cocktail explosif dont s’abreuvent les survivalistes et les convaincus des thèses de la collapsologie.
« Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres ». L’un de ces monstres est issu de l’hybridation du libertarianisme politique et du libéralisme économique. Cette hydre hideuse s’est échappée de Chicago au début du siècle dernier et son influence néfaste se fait sentir dans nos rues depuis les années 1980’, et plus encore depuis 2014 : marchandisation des biens et services à la collectivité, politique d’austérité permanente, démantèlement de nombreux dispositifs de l’Etat social et régression des législations en matière d’accessibilité aux droits sociaux.
Mais, comme l’écrivait l’équipe du CBCS en mai dernier : « Cette crise montre aussi que, face à l’urgence, il est possible d’imaginer et de réaliser des transformations jusqu’alors impensables, il est possible de casser les logiques les plus ancrées et remettre en cause les règles les plus solides. Les discours critiques et les propositions alternatives prennent soudain de l’épaisseur et s’ancrent davantage dans la réalité. Ce moment de créativité, nous pouvons le saisir pour lutter contre les inégalités, renforcer la solidarité, élargir la participation à la prise de décision, bref viser une vie meilleure pour le plus grand nombre. Ce que nous vivons tous aujourd’hui – mais avec une exposition inégale au risque – montre que l’organisation des systèmes socio-sanitaires, comme celle des autres pans de la vie en société, est avant tout un choix politique. »
Jacques Moriau enfonce le clou : « (…) la période que nous vivons est assurément exceptionnelle et étrangement porteuse d’espoir en ce qu’elle permet d’apercevoir un autre horizon que celui de la concurrence généralisée, des inégalités structurelles et de la défiance. Elle indique d’autres directions, d’autres possibles. Mais le rapide retour à la normale montre aussi que l’idée du commun ne perdure pas si on ne le travaille pas. Ce qu’indique cette crise c’est que, s’il y a moyen de faire commun en théorie, il faut encore trouver les moyens pratiques de le réaliser avant que l’idée ne s’évanouisse. »
« La seule manière d’y arriver, nous dit Amaury Ghijselings « c’est de réaliser un vrai changement d’échelle au niveau des politiques publiques ! Avec les populations pauvres et les moyens revenus, et pas uniquement du côté des populations riches. Actuellement, tout est axé sur la propriété privée plutôt qu’à partir des entreprises publiques. La véritable question est « de quoi a-t-on besoin pour assurer les besoins sociaux et environnementaux de la société dans un intérêt commun ? ».
Pour le dire autrement, si le vieux monde se meurt, œuvrons dès à présent à faire naître le suivant avant que l’obscurité nous envahisse irrémédiablement. Emerveillons-nous devant cette incroyable vivacité des collectifs progressistes – mouvements sociaux éphémères souvent, mais soutenus pour la plupart par des structures associatives institutionalisées – qui esquissent un avenir plus solidaire que notre présent ! Le CRISP a consacré un dossier à cette vivacité, et même si cette recension ne revendique aucune exhaustivité, sa lecture est revigorante. La mise en place d’une Ecole de Transformation Sociale à Bruxelles a rendu visible « ce besoin vital et vivifiant de faire ensemble », souligne S. devlésaver. Prendre conscience de cette force du collectif n’a rien d’anodin, c’est le point de départ de résistances et de transformations potentielles.
Toutes ces initiatives réuniront-elles à suffisance notoriété, confiance et adhésion pour déclencher ce basculement tant attendu qui nous conduira vers un Etat social 2.0, un Etat solidaire ?
Réussirons-nous enfin une véritable convergence des luttes pour dépasser ce paradoxe que nous vivons aujourd’hui : pour combattre le COVID-19, nos Etats, suivant en cela une seule expertise médicale, la virologie, ont mis violemment à mal nos vies sociales, nos libertés fondamentales, notre économie et, pour un pourcentage assez inquiétant d’entre nous, notre santé mentale. Sans demander notre avis, sans nous faire participer aux décisions, en nous infantilisant. A côté de cela, une palanquée d’experts, et pas tous climatologues, implorent depuis des années les Etats de lutter efficacement contre le réchauffement de notre planète, une partie importante de la population se dit prête à œuvrer dans ce sens – surtout parmi les jeunes (notre avenir). Et que font les Etats ? Trop peu. Plusieurs initiatives marient aujourd’hui luttes environnementale et sociale, même si la démarche reste encore « un peu maladroite ». (Voir interview)
Réussirons-nous enfin à sortir d’un entre-soi confortable mais stérile ? « L’essentiel des colloques et rencontres dans les secteurs du social – santé bruxellois sont fréquentés par des convaincus. Ces groupes sont socialement homogènes et leurs participants ont des profils assez semblables. », pointe Cécile Vanden Bossche. C’est là tout l’enjeu du travail social relevé par l’analyse de V. Georis : comment intégrer les personnes invisibilisées et rendues silencieuses par la violence ordinaire des décisions politiques à des luttes communes ? « Comment reprendre le contrôle, se dégager du pouvoir invisible des mots et des institutions inégalitaires ? » …
Déjà, nous ne nous contentons plus d’additionner les constats mais alignons avec force et conviction des alternatives riches de sens. Déjà, nous militons pour les inscrire à l’agenda politique. En ce sens, le CBCS adhère au mouvement Faire Front (front social, écologique et démocratique pour réinventer l’avenir : WWW.FAIREFRONT.BE) qui ambitionne de donner chair à une convergence des luttes. Le CBCS est également cheville ouvrière du Collectif21 (WWW.COLLECTIF21) qui lui, réinterroge les liens entre pouvoirs publics et associatifs subventionnés, à l’occasion de l’enterrement de la Loi de 1921 sur les ASBL, AISBL et Fondations et leur rattachement au Code des sociétés. Via son implication dans l’organisation de l’Ecole de Transformation Sociale, le CBCS ambitionne de donner aux travailleurs des secteurs social et santé des clés de compréhension de l’environnement politique, économique et institutionnel et de son impact sur leur travail quotidien.
C’est un bon début. « Nous avons ici et maintenant une fenêtre d’opportunité » Mais ce n’est pas gagné : le retour à l’anormal (mais en pire) se négocie déjà entre celles et ceux qui veulent revenir au « business as usual » le plus rapidement possible
FAIRE COMMUN,TRAVAIL SOCIAL ET RÉSISTANCES
Comment lutter ensemble – professionnels du social-santé, citoyens-usagers, militants – dans un contexte de crise sociale, économique et politique pour plus de justice sociale ?
© 2021 Copyleft: Revue Bruxelles Informations Sociales